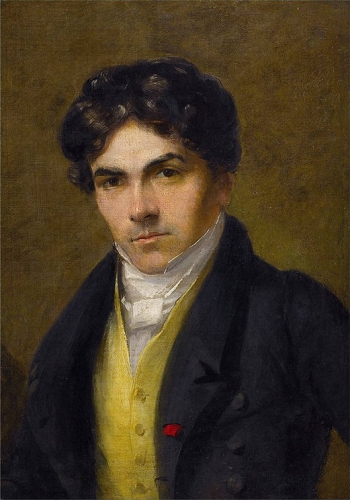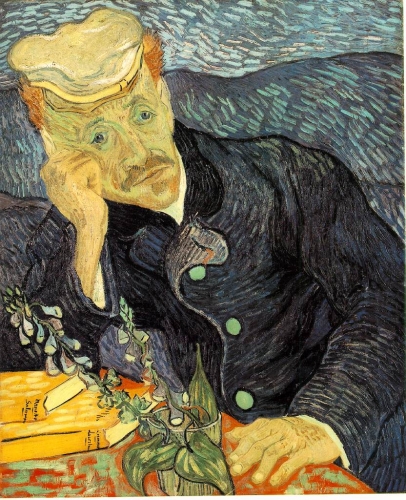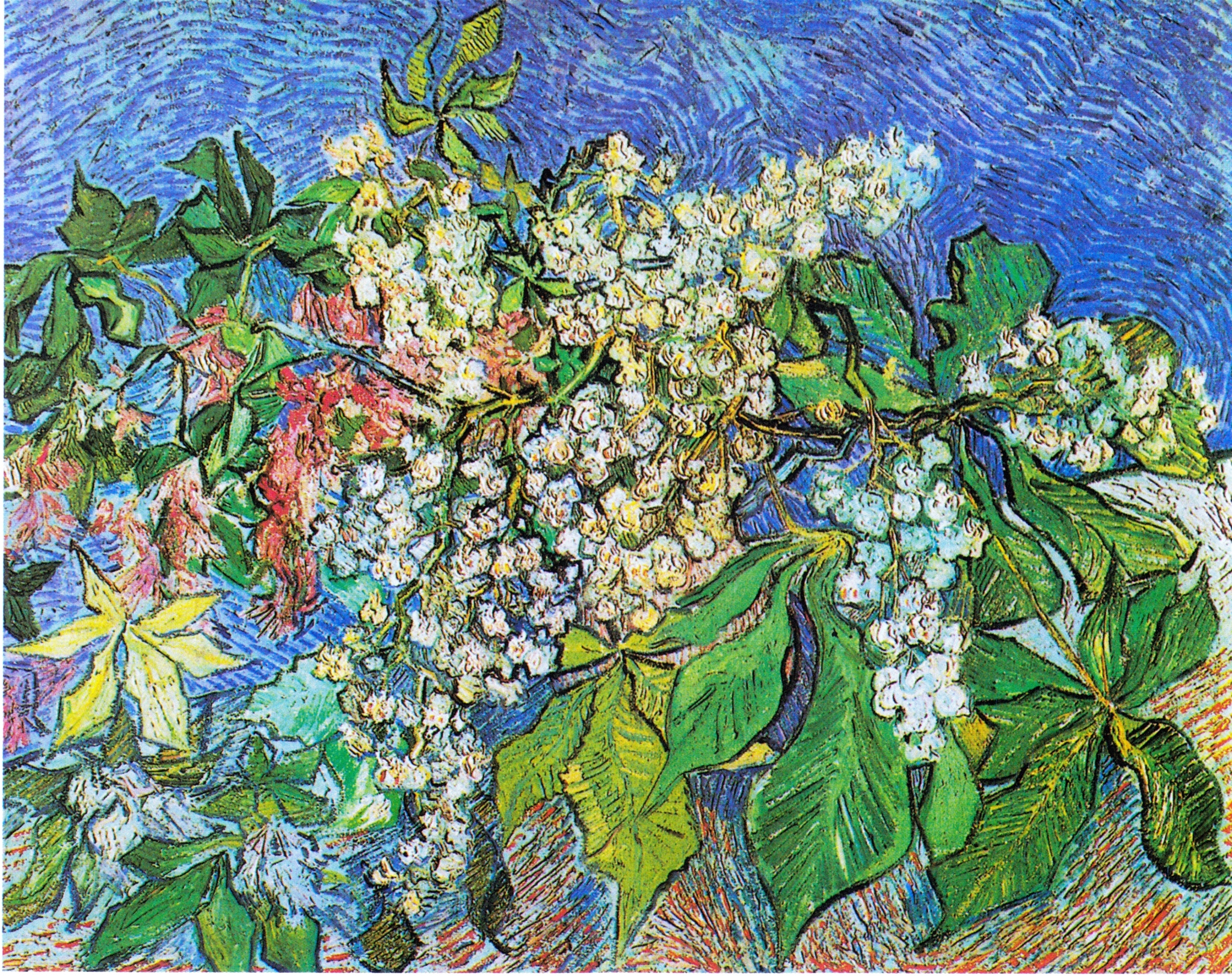Johannes Vermeer – Jeune fille à la perle, 1665, Mauritshuis, La Haye
Tout en vous souhaitant une excellente année 2019, je tenais à débuter l’année par un sourire. Pas n’importe lequel, celui de cette jeune femme qui ne cesse de nous éblouir depuis si longtemps et dont on ne se lasse pas.
Une lueur d’espoir vient de s’ouvrir pour les amateurs, comme moi, de très belles images d’œuvres d’art. Le célèbre musée du MAURITSHUIS à La Haye nous offre dorénavant le téléchargement libre en Haute Définition des œuvres de sa collection. Je viens d’obtenir La jeune fille à la perle en HD que je m'empresse de montrer ci-dessus. C’est du très haut niveau… Ne vous en privez pas.
Le Mauritshuis rejoint ainsi les quelques grands musées dans le monde qui permettent déjà le libre téléchargement en HD de leurs images dont les droits d’auteur sont tombés dans le domaine public. La culture est au prix de la qualité des oeuvres que l'on peut voir et, une nouvelle fois, je cite cette superbe phrase de la National Gallery of Art à Washington :
Le Musée croit que l'accès accru à des images de haute qualité de ses œuvres nourrit la connaissance, l'érudition et l'innovation, des utilisations inspirantes qui transforment continuellement la façon dont nous voyons et comprenons le monde de l'art.
UNE TRÈS MAUVAISE NOTE : Le musée du Louvre est devenu en 2018 le premier musée mondial en nombre de visiteurs (plus de 10 millions). Malgré cela, il est toujours impossible, sans payer, d’obtenir des images en HD de ses œuvres, ainsi que celles des autres musées français. Personnellement, je n'ai pas encore réussi à en obtenir une, même en payant un prix que l'on ne m'a pas donné. Je réessaierai...
À La vue si touchante de cette Jeune fille à la perle, merveilleuse création de Johannes Vermeer, j'ai tenté de relever mon niveau. Pas facile... Durant les fêtes j'ai écrit le poème qu'elle m'a inspiré et que je vous offre ci-dessous :
Bouche humide entrouverte, yeux brillants,
Regard caressant.
Deux perles de lumière rose
Aux commissures des lèvres, se posent.
La jeune femme me fait face, souriante
Dans l’éclat de sa jeunesse insolente.
L’aurai-je dérangée ?
Mon rythme cardiaque s’est accéléré.
Son regard croise le mien.
Il irradie, me retient.
Son souffle est parfumé,
Va-t-elle me parler ?
Aériennes, fluides, lisses,
En glacis superposés, les couleurs glissent
Vers cette fabuleuse lumière
Qui n’appartient qu’à Vermeer.
Dans cette figure lumineuse aux contours indécis.
Galbe de la joue, bouche, nez, semblent imprécis.
Faut-il compléter les parties manquantes
Laissées dans cette peinture fascinante ?
Poussière de perles écrasées,
Peau douce immaculée,
Etrange turban exotique dont les plis frémissent,
À qui appartint-il jadis ?
Qui peut être cette femme troublante
Une fille de Delft, une jeune servante ?
Beauté irréelle au visage précieux, fragile,
Sous son oreille, une perle brille.
Par ce portrait hors du temps
L’artiste nous transporte habilement
Bien au-delà de l’apparence,
Au-delà même de notre propre existence.